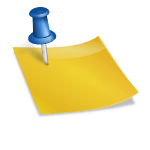L’équipe bretonne se distingue en Ligue 2
Depuis le début de la saison, l’équipe bretonne s’illustre au sommet du classement dans un championnat souvent jugé peu attractif. Malgré des complications internes concernant la direction du club au début de la saison et l’arrivée de 60 % de nouveaux joueurs durant l’intersaison, cette équipe ne faisait pas partie des favorites pour grimper en Ligue 1. Sous la conduite de Jean Marc Furlan, un entraîneur expérimenté et audacieux dans sa stratégie, le Stade Brestois démontre jour après jour qu’il faut désormais compter sur eux pour l’accession à la Ligue 1. Ils offrent un projet de jeu et une animation plaisante qui ravissent les amateurs de football. Focus sur leur évolution.
N.B : Si vous visitez le site pour la première fois, n’oubliez pas de lire ma section À propos, qui est essentielle pour comprendre l’ensemble du site. Je suis certain qu’elle vous plaira.
Composition de l’équipe
Officiellement alignée en 4-3-3, l’équipe dirigée par Jean Marc Furlan se montre variée dans son animation offensive avec de multiples mouvements. Lorsque l’équipe a l’opportunité de construire depuis l’arrière, la pointe du triangle au milieu, Coeff ou Grougi, redescend pour aider les défenseurs centraux à s’écarter et permettre aux latéraux de monter. Ce principe d’animation est courant dans les formations en 4-3-3 pour relancer en toute sécurité face au pressing adverse. Toutefois, l’entraîneur de Brest impose aussi d’autres options pour relancer efficacement. Parfois, un autre milieu, comme Batocchio ou Faussurier, vient occuper la zone du latéral, permettant ainsi de libérer ce dernier.
Ces mouvements obligent souvent l’adversaire à choisir entre le suivre, ouvrant ainsi l’axe à un appel, ou le laisser libre, offrant plus de créativité au milieu de terrain.
Une fois en attaque, les qualités techniques des joueurs favorisent les décalages. Leur capacité à alterner entre jeu court et jeu long, couplée aux nombreux déplacements et permutations des ailiers et milieux, permet d’atteindre les 30 derniers mètres adverses. Lors d’une construction de jeu court, deux configurations se dégagent. D’abord, ils s’appuient sur Neal Maupay, qui décroche pour offrir des soutiens et des remises, facilitant les combinaisons avec les milieux ou ailiers. Ensuite, ils exploitent les ailes, les latéraux se projetant dans le camp adverse lorsque leurs ailiers rentrent dans l’axe. Des combinaisons rapides entre 2 ou 3 joueurs, basées sur une circulation fluide du ballon, perturbent souvent la défense adverse grâce à leur agilité.
Exemple de jeu typique
Imaginez une action qui débute sur le côté, avec le latéral qui se dédouble, un soutien proche du milieu relayeur, et Maupay en position favorable pour créer un surnombre ou conclure dans la surface. Ceci illustre une approche triangulaire pour générer des décalages.
De plus, l’équipe de Brest ne se limite pas à une approche de jeu court ; elle excelle également dans le jeu long utilisé à propos. Des joueurs en puissance comme Pelé ou Lavigne pratiquent souvent des passes transversales. Face à des blocs médians, des relances en profondeur sont souvent tentées par Coeff, Grougi ou Castan pour atteindre Maupay ou ses remplaçants, Joseph Monrose ou Diallo.
Finition des actions
Sur la phase de finition, les possibilités sont variées. Ils exploitent fréquemment les centres, surtout au sol, puisque les attaquants de Brest ne se distinguent ni par leur taille ni leur efficacité aérienne. Notons que c’est au cours d’une phase de ce type que Maupay inscrit son second but lors d’un match décisif contre Strasbourg. Les frappes à distance, les combinaisons, et les dribbles pour obtenir des pénaltys sont d’autres atouts de l’équipe de Furlan. Cependant, ils nécessitent souvent de multiples occasions avant de convertir, ce qui peut s’avérer coûteux.
Récupération et transitions
Défensivement, Brest varie entre deux configurations. Quand l’adversaire récupère le ballon bas ou effectue une passe en arrière, Maupay, Faussurier et un autre joueur (généralement un ailier) initient un pressing sur les défenseurs centraux pour les pousser à dégager ou à commettre une erreur technique.
Par exemple, lors du match contre Le Havre, les relanceurs adverses faisaient face à un pressing acté par ces trois brestois.
Dans d’autres situations, le bloc se compresse en 4-1-4-1 au niveau de la ligne médiane, laissant les défenseurs centraux adverses libres et mettant la pression après la première passe. Si l’adversaire passe dans l’axe, l’avantage en nombre au milieu leur permet souvent de récupérer le ballon collectivement. Lorsque l’équipe adverse attaque par les côtés, le bloc brestois déplace son organisation en fonction du ballon, tentant d’entraver le jeu adverse près de la ligne de touche.
Cependant, il est à noter que Brest use peu des phases de transition après une récupération dans leur propre camp. Hormis un jeu long direct vers Maupay ou Pelé, ils préfèrent repartir sur une construction posée, un domaine que Furlan devra améliorer pour une éventuelle montée en Ligue 1.
Les joueurs clés
Une des forces de l’effectif brestois réside dans son homogénéité, où de nombreux joueurs sont interchangeables et polyvalents. Jean Marc Furlan bénéficie de nombreuses options au milieu et sur les ailes, si bien qu’il est rare qu’il aligne le même onze de départ. Coeff, Grougi, Faussurier, Battochio, Perez se battent pour trois places centrales. Des joueurs comme Steven Joseph Monrose, Zakarie Labidi, et Valentin Henry sont des options convaincantes en attaque. Néanmoins, certains éléments se démarquent. Bryan Pelé, jeune joueur de 24 ans formé à Lorient, est un atout précieux. Avec sa petite taille, il se révèle être un véritable électron libre, alliant mobilité et bonnes compétences techniques, parfaitement en phase avec la philosophie de jeu de Furlan. Ses mouvements et ses combinaisons avec Neal Maupay représentent un danger constant pour les defenses adverses.
Neal Maupay, pour sa part, est un atout clé avec 8 buts en 14 matchs. Formé à Nice, il conjugue des qualités similaires à celles de Pelé avec une finition supérieure. Julien Faussurier, jouant un rôle central chez Brest, est un autre pilier; ancien du Troyes, il occupe diverses positions au milieu et joue un rôle tactique essentiel, à 29 ans.
Cohérence de l’effectif
La réussite de l’équipe de Brest est le fruit d’une construction cohérente. L’entraîneur et son staff ont su recruter des joueurs compatibles avec la philosophie de jeu dynamique, technique, et rapide que Furlan souhaite développer. Des joueurs comme Bryan Pelé, Valentin Lavigne, et Alexandre Coeff viennent du centre de formation de Lorient, tandis que Faussurier et Nganioni ont été formés à l’OL. Neal Maupay, quant à lui, est issu de Nice, reconnu pour son excellent travail de formation. Ainsi, le succès de Brest n’est pas le fruit du hasard, mais d’une recherche ciblée de talents dans de bons centres de formation.
Conclusion
Il est réjouissant de soutenir une équipe française en Ligue 2 qui lutte pour atteindre l’échelon supérieur tout en affichant une identité de jeu ambitieuse et technique. Il faut reconnaître que ce succès est le résultat d’un travail méticuleux en un temps record, puisque c’est la première saison de Jean Marc Furlan à Brest. Avec un budget de 12 à 13 millions d’euros, ce club prouve qu’il est possible de gagner tout en offrant un spectacle attrayant à ses supporters, sans pour autant compromettre ses finances dans un championnat souvent critiqué pour son conservatisme. Grâce à du sérieux, de l’exigence et du travail acharné, Brest aspire à un avenir radieux en juin 2017.
Bilan
Points forts :
- Un effectif homogène et techniquement solide.
- Un gardien et un attaquant de qualité.
- Un entraîneur ambitieux souhaitant maîtriser chaque match.
- Capacités à conserver le ballon et à déséquilibrer par le jeu court et long.
- Récupération collective du ballon avec différentes configurations.
- Un banc de qualité pour la Ligue 2.
Axes de progrès :
- Un manque de solidité sur les coups de pied arrêtés défensifs.
- Une inefficacité sur les coups de pied arrêtés offensifs.
- Une tendance à la conservation stérile du ballon.
- Beaucoup d’occasions nécessaires pour marquer.
- Un faible apport des défenseurs centraux dans les relances.
- Des améliorations à apporter au jeu de transition.

Fan de foot depuis toujours, je prends plaisir à suivre les matchs et en discuter.
Quand j’ai un moment, j’écris tranquillement mes impressions et mes petites analyses.
C’est juste ma manière de partager ce que j’aime, sans prise de tête ⚽️.