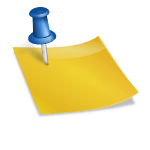Une Ligue 1 en pleine mutation
En 2023, la question se pose : la Ligue 1 est-elle vraiment ce championnat, ce “paradis des vainqueurs” qui attribue toujours le mérite « à celui qui gagne, parce qu’il a été plus fort que les autres » (1) ? Est-elle encore dominée par ceux qui persistent à affirmer que « Ça me va si on n’est pas très bien dans le jeu et qu’on est capables de gagner » (2) ou qui disent « si vous voulez du spectacle, allez au cirque ! » (3) ? Didier Deschamps est-il toujours considéré comme « l’élu », représentant ultime de l’entraîneur français, symbolisant à la fois l’excellence du savoir-faire footballistique et la banalité d’une vision du sport déconnectée des sentiments et des émotions ? Si ces affirmations pouvaient sembler évidentes il y a une dizaine d’années, elles sont moins certaines aujourd’hui.
Le football global actuel est marqué par un fétichisme pour la compétition et une adoration des résultats. Cependant, rappelons que ce sport a toujours été, à ses débuts (4), un jeu, impliquant une activité libre, sans score. Dans cette dynamique contradictoire, comment les entraîneurs de Ligue 1 se positionnent-ils aujourd’hui ? Alors que la France, à travers son championnat, évolue au sein d’une guerre culturelle et idéologique européenne et mondiale, de nouveaux profils d’entraîneurs émergent. Ces derniers redéfinissent progressivement la culture footballistique française : échanges ouverts autour du jeu, prise en compte du spectacle, critique de l’attentisme, et promotion de modèles de jeu protagonistes, indépendamment du budget du club. Nous nous attacherons ici à analyser cette évolution en étudiant trois entraîneurs de Ligue 1.
Évaluer les entraîneurs : Franck Haise, Régis Le Bris et Paulo Fonseca
Les questions au cœur de cette étude sont les suivantes : comment Franck Haise, Régis Le Bris et Paulo Fonseca défendent-ils un idéal de jeu « protagoniste » face au Paris-Saint-Germain, l’équipe la plus performante du championnat ? Comment se traduisent ces modèles de jeu sur le terrain ?
Note au lecteur : Cette analyse repose sur un échantillon de trois matchs spécifiques : les confrontations de Lens, Lille et Lorient contre le Paris-Saint-Germain lors de la saison 2022/2023. Bien que les opinions formulées ici soient défendues avec conviction, ce document n’a pas vocation à l’exhaustivité ni à l’objectivité totale. Les opinions exprimées ne reflètent que celles de l’auteur. De plus, les citations des entraîneurs sont en partie issues de l’assistance d’Alexandre Haddad, à qui nous exprimons notre gratitude. Crédits photo : iconsport, les statistiques peuvent provenir de whoscored.com, Opta et Fotmob.com.
Le chemin vers l’idéal de jeu : la quête de Régis Le Bris
Il est important de noter que Régis Le Bris n’est pas l’unique entraîneur pertinent dans l’immersion d’une culture football protagoniste en Ligue 1. Nous avons précédemment abordé la remarquable mission de Pascal Gastien à Clermont ou de Jean Marc Furlan à Brest. Au cours de la saison 2022-2023, les actions d’entraîneurs tels que Philippe Montanier à Toulouse, Philippe Clement à Monaco, Will Still à Reims ou Igor Tudor à Marseille pourraient également enrichir cette analyse. Ces remarques soulignent la subjectivité de l’analyse proposée ici.
Dans ce paysage d’entraîneurs, l’histoire de Régis Le Bris illustre celle du coach « chercheur ». Son parcours personnel offre des indications précieuses sur les évolutions des profils au sommet du football français. Né en Bretagne, profondément attaché à sa région, il a d’abord fait ses armes en tant que jeune joueur au Stade Rennais. Face à la forte concurrence, sa progression dans l’équipe professionnelle s’est avérée difficile, le conduisant à quitter le club pour le Stade Lavallois en deuxième division, principalement en raison d’un faible temps de jeu. Nous sommes au début des années 2000, et bien que le club de la Mayenne ne soit pas le tremplin rêvé pour sa carrière, il y va faire une rencontre clé avec Franck Haise (5), que nous retrouverons plus loin dans cet article.
Après un nouveau revers à Laval, il se dirige vers la Belgique où, à 27 ans, il met un terme prématuré à sa carrière de joueur. Dans un long entretien pour So Foot, il évoque une des raisons de cet arrêt : « Or, quand j’étais joueur, il n’y avait pas forcément d’intentions dans toutes les phases de jeu. Ça finissait par un : « tu n’es pas performant. » Ok, mais comment je peux l’être davantage ? Pas de réponse. Certains entraîneurs étaient incapables d’argumenter, parce qu’il n’y avait, en réalité, aucune intention sous-jacente. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai vite arrêté. »(6)
Il était donc déjà, à seulement 27 ans, en train de subir une transformation. Un changement mental. Le passage d’une approche immersive et d’exécution vers une position plus réflexive et organisationnelle. Une véritable métamorphose du préparateur d’aujourd’hui. Bien sûr, personne n’imaginait qu’il deviendrait entraîneur, et lui-même le reconnaît : « Mon histoire personnelle s’est écrite au gré des rencontres, des opportunités. Je ne dirais donc pas qu’il y avait un plan préalable.» (7). Titulaire d’un doctorat en STAPS, il soutient une thèse sur « l’étude biomécanique de la course à pied » en 2006. Parallèlement, il s’engage dans la formation des jeunes au sein de l’ES Wasquehal. Puis, sa carrière prend de l’ampleur. Entraîneur de catégories jeunes jusqu’à U19 à l’échelon national pour Rennes et Lorient, il devient responsable du centre de formation du FC Lorient de 2012 à 2022, l’année de son intégration à l’équipe professionnelle des Merlus.
Une influence croissante dans le football français
Ce parcours succinct, mais révélateur, est d’une grande importance dans le paysage actuel du football français. Il incarne un homme qui ne cherchait pas à « se recycler par défaut » à un poste d’entraîneur professionnel, mais qui endosse plutôt un rôle de chercheur. En se distanciant de l’accélération de la compétition quotidienne, il parvient à réfléchir à des processus et à des échelles temporelles variées, en résonance avec les attentes de la FFF formulées depuis la fin des années 2010 pour les formations d’élite. Il utilise également la conférence de presse, non pas comme une tribune pour un « coup de gueule », mais pour partager ses réflexions sur le jeu avec le public. En somme, il incarne les évolutions difficiles mais substantielles qui semblent s’opérer parmi les entraîneurs de haut niveau en France. En mettant en avant leur passion pour le jeu, il invite les observateurs à s’améliorer, à progresser, et ainsi, à enrichir la culture footballistique. Cette tendance se maintiendra-t-elle dans le temps ou s’agit-il simplement d’un effet de mode ? L’avenir tranchera.
L’affrontement de son équipe contre le Paris-Saint-Germain le dimanche 6 novembre 2022 constitue un test intéressant quant à sa capacité à adopter une posture protagoniste face à un adversaire plus fort sur tous les fronts. Comment celui pour qui « le plaisir d’une sortie de balle, ça génère beaucoup de choses » (8) s’est-il adapté face à un tel défi ? Vous pouvez le découvrir dans la vidéo ci-dessous :
La deuxième route vers l’idéal de jeu : le travail ambitieux mais non récompensé de Paulo Fonseca
À l’instar de Régis Le Bris, Paulo Fonseca représente l’histoire d’un entraîneur ayant eu une carrière de joueur dans l’ombre des projecteurs. Défenseur central modeste, il a évolué dans plusieurs clubs portugais de haut niveau, comme le CF Belenenses ou le Vitoria Guimaraes. Bien qu’il ait saisi les codes du football professionnel, il ne peut pas se prévaloir d’une « légitimité » d’ancien grand joueur pour accentuer l’autorité de ses préceptes et de sa philosophie de jeu. Comme son homologue breton, la relation qu’il développe avec ses joueurs repose non sur l’autorité ou la légitimité, mais sur sa capacité à créer du lien et à fédérer autour de sa vision du sport, tant sur le terrain qu’en dehors.
En tant qu’entraîneur depuis 2007-2008, sa notoriété commence réellement à se forger lors de la saison 2012-2013 à la tête de Paços de Ferreira, où il réalise l’exploit d’emmener cette équipe peu connue à la troisième place du championnat portugais, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Il est alors reconnu dans son pays comme un technicien capable de concilier créativité et efficacité, même avec une effectif réduit (Josué ? Diogo Figueiras ? Hurtado ?). Il continue ensuite à entraîner des clubs d’envergure comme le FC Porto, l’AS Roma ou le Shaktar Donetsk avant de rejoindre Lille en 2022. Dans chaque établissement, Paulo Fonseca s’efforce de maintenir l’image d’un football offensif et créatif, où ses équipes visent à dominer plutôt qu’à subir, malgré des confrontations inégales.
Déclaration de ses ambitions et analyse critique
La philosophie de Fonseca a été exposée au public français lors d’un entretien avec So Foot en février 2023 (9). À l’instar de Régis Le Bris, il livre une critique de son expérience en tant que joueur et affirme se sentir plus épanoui comme entraîneur : « À mon époque, le football était très physique, très basique. Personne ne m’a jamais parlé de la rotation du corps, du pied par exemple. Tous ces détails, j’en ai pris conscience en parlant avec d’autres entraîneurs, en discutant avec mes adjoints et en regard, beaucoup, beaucoup de matchs. En toute honnêteté, je n’ai jamais été un grand footballeur, c’est peut-être pourquoi je ne suis pas nostalgique de cette époque… Je préfère le rôle d’entraîneur.
Tout comme son homologue français, Fonseca observe et analyse le travail de ses collègues autour du monde, cherchant inspiration et nouvelles idées. Conscient de la réalité compétitive de son sport, il retrouve dans son observation une passion pour le jeu : « Guardiola a dit plusieurs fois qu’il était un voleur d’idées. En réalité, tous les entraîneurs le sont. Moi, j’observe particulièrement ce que font Guardiola, Arteta, Emery et De Zerbi. Ce sont des entraîneurs qui tentent toujours de faire évoluer le jeu. » Observer ne signifie pas copier, et Fonseca souligne l’importance d’adapter ses idées aux spécificités de son environnement : « les entraîneurs sont des voleurs d’idées, mais ils commettent souvent la même erreur : copier. Il est crucial de savoir si ce qui fonctionne ailleurs peut être valable ici. Ce n’est pas parce que City joue d’une certaine manière qu’il faut nécessairement reproduire leur modèle.
Se nourrir des autres pour bâtir son identité, celle que souhaite le LOSC : « Ce qui a fait la différence, c’est le discours des dirigeants, leur désir d’instaurer un football offensif. Offensivement, la plupart des équipes jouent en transitions rapides ou en contre-attaques. En observant cela, j’ai compris qu’il était possible de donner une nouvelle direction au LOSC, de le transformer en une équipe dominante. » À l’heure où ces lignes sont écrites, certaines statistiques illustrent cet objectif ambitieux : 2ème du championnat en Expected Goals (52.2, juste derrière le PSG qui affiche 60), 2ème au nombre de tirs par match (6.0), Jonathan David devenant le deuxième meilleur buteur du championnat, et une place élevée en passes décisives (11). La tendance est claire : l’équipe préfère conserver le ballon qu’attendre l’adversaire.
Face à une équipe comme le PSG, réputée pour dominer ses adversaires, comment Fonseca a-t-il abordé cette rencontre ? A-t-il réussi à aligner son discours avec les actes ? La vidéo ci-dessus met en lumière le fait que le score final peut souvent être trompeur quant aux dynamiques présentes sur le terrain. Bien que quelques statistiques (12) permettent d’apporter un éclairage différent, le PSG demeure largement au-dessus en termes d’xG (3.65 contre 1.68 côté lillois), de « Big Chances » (9 pour le PSG contre 3 pour le LOSC), ou de taux de conversion (43% face à 6% côté lillois). Les Parisiens ont offert une prestation offensive de qualité, marquant dès le début avec une combinaison efficace, tout en exploitant les petits espaces et jouant en profondeur, capitalisant sur les erreurs des défenseurs. Néanmoins, les Lillois ont prouvé qu’il était possible de conserver le ballon (499 passes pour 541 côté PSG) et de tirer fréquemment (16 tirs chacun), défiant les champions de France dans les tacles réussis (5 contre 8), les interceptions (15 contre 5) et les duels aériens (50% de réussite chacun).
Dès lors, cette défaite 7-1 contre le PSG est-elle la mise à l’échec définitive du modèle de jeu défendu par l’entraîneur portugais ? Ce dernier refuse d’abandonner : comme son collègue Régis Le Bris, il considère le résultat non pas comme le seul critère d’évaluation, mais comme un élément fondamental, mais non exclusif dans l’analyse de la performance : « Ce soir, tout le monde a retenu le nombre de buts encaissés. Pourtant, nous avons montré de belles choses en jeu. Je me souviens également que nous avons tenté 16 tirs. Pour les entraîneurs, ce qui compte vraiment, c’est le message que nous envoyons aux joueurs. Si je crois réellement en ma philosophie, je ne peux pas entrer dans le vestiaire en disant : « bon, les gars, aujourd’hui on joue contre le PSG, et nous allons défendre ». Imaginez ce que cela provoquerait dans leur tête. Un mot est fondamental : le courage.
Comparaison des approches de jeu
Pour conclure, il est important d’aborder les différences d’approche entre Régis Le Bris et Paulo Fonseca. L’entraîneur breton privilégie une stratégie plus mesurée, n’ayant pas été en mesure de proposer des séquences de sortie de balle ou d’attaques placées aussi efficaces et fréquentes. Cela dit, le FC Lorient se montre plus dangereux durant ses périodes de possession, en étant plus incisif lors des finalisations que leurs homologues lillois (comme lorsque Moffi touche la transversale depuis la surface). Ces analyses révèlent aussi deux façons distinctes de désavantage le PSG, deux méthodes centrées sur les caractéristiques des différents joueurs dans leur modèle de jeu : les Merlus s’appuient sur le jeu en largeur, tandis que le LOSC exploite la profondeur depuis son propre camp.
Concernant les phases sans ballon et les transitions, deux stratégies intéressantes peuvent être comparées. Lorient privilégie la fermeture des espaces tout en poussant les Parisiens à évoluer dans des zones restreintes près du but de M’Vogo. En restant fidèle aux traditions lorientaises, Régis Le Bris adopte une défense de zone, à l’inverse du LOSC qui se retire le plus loin possible de son but, mise sur les marquages individuels ou mixtes, et laisse des espaces en se fiant à un pressing efficace pour empêcher les pénétrations et transiter rapidement près du but parisien. Les joueurs comme Ouattara, Moffi et Le Fée à Lorient doivent parcourir une plus grande distance depuis leur camp pour poser problème au PSG en contre-attaque. Malheureusement, ces deux stratégies montrent aussi leurs limites. Bien que les deux entraîneurs défendent un modèle ambitieux, Protagoniste, ni Régis Le Bris ni Paulo Fonseca n’ont réussi à obtenir un résultat positif face à Galtier. Comment Franck Haise a-t-il réussi là où les deux autres ont échoué ?
La troisième route vers l’idéal de jeu : l’éclair de génie de Franck Haise
Franck Haise, comme ses prédécesseurs, partage certaines similarités dans son parcours de joueur devenu entraîneur. Bien qu’il ait progressé jusqu’au monde professionnel, il n’a jamais atteint le sommet. Sa formation à Rouen l’a vu évoluer majoritairement en Ligue 2, au Stade Lavallois, Beauvais, puis Angers. Lui aussi, comme Régis Le Bris ou Paulo Fonseca, est issu de la défense, jouant en tant que milieu de terrain défensif ou arrière gauche. Bien qu’il dispose de qualités footballistiques, il se distingue surtout par ses qualités humaines auprès de ses coéquipiers. Des anciens entraîneurs comme Hervé Gauthier et Laurent Viaud ne manquent pas de le louer : « Avec Franck, j’ai rapidement trouvé dans le vestiaire un garçon extraverti, jovial, très professionnel et agréable à entraîner. Il dégage une immense joie de vivre et une mentalité exemplaire, autant dans la vie qu’engagé sur le terrain » (13).
Contrairement à Régis Le Bris, sa vocation d’entraîneur est rapidement apparente pour son entourage. Il manifeste une curiosité forte pour l’entraînement, échangeant souvent avec son coach, Denis Troch, lorsqu’il était joueur à Laval (14). Quand il débute sa carrière d’entraîneur au Stade Mayennais en 2003, il le fait encore sous le statut de « joueur-entraîneur » désormais désuet.
Comparé aux autres, son parcours d’entraîneur est resté dans un environnement régional restreint, s’étendant de la Mayenne à la Bretagne, en passant par les Pays de la Loire. Son passage au Stade Mayennais jusqu’en 2006, suivi du Stade Rennais jusqu’en 2012, puis du FC Lorient jusqu’en 2017, le mène finalement au RC Lens. Au cours de ce parcours, il rencontre sollicite de nombreuses personnalités qui influencent son identité footballistique, comme il l’explique dans une interview accordée à l’Equipe le 4 mars 2023 (15) en abordant l’importance de son formateur Daniel Zorzetto : « il savait que j’avais cette fibre d’éducateur, cette volonté d’entraîner. C’est avec lui que j’ai commencé à élaborer des séances plus complexes, basées sur le plaisir du jeu. » Il évoque aussi des influences telles qu’Arsène Wenger : « Le parcours et la longévité d’Arsène Wenger sont inspirants. Ce qu’il a réalisé en vingt-deux années à Arsenal est exceptionnel. Au-delà de ses qualités humaines et d’entraîneur, il faut aussi envisager ce qu’un club doit devenir dans trois, cinq ans. » Enfin, plusieurs de ses collègues entraîneurs, qu’il a rencontrés à Rennes ou Lorient, l’ont marqué par leur expertise, notamment Régis Le Bris : « Nous avions collaboré pendant six ans au Stade Rennais, et il est revenu me chercher à l’US Changé un an après avoir pris la tête du centre de formation de Lorient. Avec Régis, c’est une inspiration réciproque, capable de structurer ses idées et de les mettre en pratique avec une vision claire.
Cette ébauche de Franck Haise illustre une montée fulgurante jusqu’à un statut de coach de haut niveau au RC Lens. Il rejoint l’équipe réserve et prend en main la succession de Philippe Montanier (actuellement à Toulouse, lui aussi fascinant à observer), développant un jeu complet qui le propulse en Ligue 1 lors de la saison 2020/2021. L’année suivante, il dépasse les attentes du club en se classant 7ème, enthousiasmant les experts et mettant en lumière des joueurs talentueux comme J. Clauss, S. Fofana (provenant de l’Udinese), ou plus récemment S. Abdul Samed (Clermont Foot), L. Openda, J. Gradit, et bien d’autres. Tout cela repose sur un modèle de jeu raffiné ; la progression de son équipe est vertigineuse, menant le RC Lens aux portes de la Ligue des Champions en s’installant à la 3ème place de la Ligue 1.
Le modèle de jeu a fait l’objet d’une analyse approfondie par de nombreux experts (16), mais nous nous concentrons ici sur la performance de Lens contre le PSG. En mobilisant des éléments “protagonistes”, cette performance se solde par un match collectif de haute volée ainsi qu’un résultat positif. Tentative d’explication :
Statistiques clés (17) : Les chiffres renforcent l’impact exceptionnel du RC Lens : les hommes de Franck Haise dominent en Expected Goals (1.76 contre 1.62), en

Fan de foot depuis toujours, je prends plaisir à suivre les matchs et en discuter.
Quand j’ai un moment, j’écris tranquillement mes impressions et mes petites analyses.
C’est juste ma manière de partager ce que j’aime, sans prise de tête ⚽️.